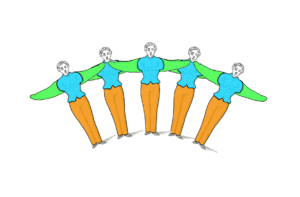IRONIK
Avatars des identifications – argument du colloque UFORCA 2023, en visio conférence
Gil Caroz
n°55
![]() Si l’on se réfère à deux des significations du mot avatar, celles d’événement fâcheux et de transformation, identifications et avatars vont de pair. Il n’y a pas d’identification tranquille et immuable. Le psychanalyste en est souvent témoin quand un sujet lui adresse la demande de restaurer une identification qui a vacillé. Car si l’identification est une première modalité de rapport à l’Autre, il n’en demeure pas moins qu’elle est un élément venant recouvrir la barre qui frappe le sujet d’une division, et ce trou peut ressurgir derrière cette couverture. Par ailleurs, si l’identification est toujours faite d’un signifiant prélevé chez l’Autre, elle est également corrélée, d’une façon ou d’une autre, à une jouissance. La moustache de Hitler, comme trait unaire qui condense son « tout petit plus-de-jouir 1 », est un exemple paradigmatique de signifiant investi de jouissance autour duquel s’organise l’identification d’une foule. Or, signifiant et jouissance sont deux éléments hétérogènes. Leur articulation n’étant jamais parfaite, elle ne peut que produire des avatars.
Si l’on se réfère à deux des significations du mot avatar, celles d’événement fâcheux et de transformation, identifications et avatars vont de pair. Il n’y a pas d’identification tranquille et immuable. Le psychanalyste en est souvent témoin quand un sujet lui adresse la demande de restaurer une identification qui a vacillé. Car si l’identification est une première modalité de rapport à l’Autre, il n’en demeure pas moins qu’elle est un élément venant recouvrir la barre qui frappe le sujet d’une division, et ce trou peut ressurgir derrière cette couverture. Par ailleurs, si l’identification est toujours faite d’un signifiant prélevé chez l’Autre, elle est également corrélée, d’une façon ou d’une autre, à une jouissance. La moustache de Hitler, comme trait unaire qui condense son « tout petit plus-de-jouir 1 », est un exemple paradigmatique de signifiant investi de jouissance autour duquel s’organise l’identification d’une foule. Or, signifiant et jouissance sont deux éléments hétérogènes. Leur articulation n’étant jamais parfaite, elle ne peut que produire des avatars.
La clinique avec les enfants
Agnès Vigué-Camus
n°54
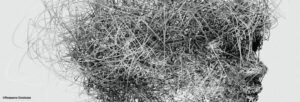 L’enfant relève-t-il d’une pratique clinique différente de celle des adultes ? Cette question suscita des controverses dans le milieu analytique. La société britannique de psychanalyse vit ainsi s’affronter, durant la Seconde Guerre mondiale, les partisans d’Anna Freud et ceux de Melanie Klein1. Pour les premiers, l’analyste devait tenir compte du lien privilégié entre l’enfant et ses parents. M. Klein, pionnière en cela, se repérait sur ce qu’exprimait un enfant qui ne disait parfois que quelques mots, comme ce fut le cas de Dick2.
L’enfant relève-t-il d’une pratique clinique différente de celle des adultes ? Cette question suscita des controverses dans le milieu analytique. La société britannique de psychanalyse vit ainsi s’affronter, durant la Seconde Guerre mondiale, les partisans d’Anna Freud et ceux de Melanie Klein1. Pour les premiers, l’analyste devait tenir compte du lien privilégié entre l’enfant et ses parents. M. Klein, pionnière en cela, se repérait sur ce qu’exprimait un enfant qui ne disait parfois que quelques mots, comme ce fut le cas de Dick2.
Il arrive, en effet, qu’un enfant, lorsqu’on l’amène chez un clinicien, ne parle pas, mais
s’agite. Si cette agitation muette se voit le plus souvent aujourd’hui épinglée de l’inévitable
diagnostic de trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), des recherches, dans
le champ de la psychanalyse, convoquent d’autres hypothèses. ».
1 Cf. Sokolowsky L., « Melanie, femme sans doute », La Cause du désir, no 112, novembre 2022, p. 115, disponible sur Cairn.
2 Cf. Klein M., « L’importance de la formation du symbole dans le développement du moi », Essais de
psychanalyse, Paris, Payot, 1968, p. 263-278.
L’enseignement par les présentations cliniques
Agnès Vigué-Camus
n°53
 Les institutions psychiatriques qui « accueillent les présentations de malade se réduisent à peau de chagrin 1 ». Il y a vingt ans déjà, Guy Briole indiquait qu’on leur préférait les « entretiens “semi-structurés 2 ». Aujourd’hui, ce sont les cases à cocher dans un questionnaire, les échelles graduées et les items des formulaires qui s’imposent dans le champ clinique.
Les institutions psychiatriques qui « accueillent les présentations de malade se réduisent à peau de chagrin 1 ». Il y a vingt ans déjà, Guy Briole indiquait qu’on leur préférait les « entretiens “semi-structurés 2 ». Aujourd’hui, ce sont les cases à cocher dans un questionnaire, les échelles graduées et les items des formulaires qui s’imposent dans le champ clinique.
Le goût de la clinique – une éthique
Agnès Vigué-Camus
n°52
 Alors qu’une clinique du regard envahit le champ des pratiques de la parole, une éthique est plus que jamais nécessaire pour repérer un réel qui se dérobe à l’image.
Alors qu’une clinique du regard envahit le champ des pratiques de la parole, une éthique est plus que jamais nécessaire pour repérer un réel qui se dérobe à l’image.
Le langage, cet indomptable
Pénélope Fay
n°51
 Pas de psychanalyse sans parole ni langage. Au même titre que
Pas de psychanalyse sans parole ni langage. Au même titre que
l’inconscient et l’interprétation, la parole et le langage pourraient
être aussi considérés comme des « mots de la tribu ». Mais au même titre que le statut de l’interprétation peut être repensé selon que celle-ci est ponctuation ou coupure, la parole peut être conçue selon son versant autistique, vecteur de satisfaction, d’apparole. Le langage, lui, bien loin d’être seulement le réceptacle et le tourniquet des significations, peut être lieu et occasion de résonances, mettant « en valeur la matière qui, dans le son, excède le sens ». Ces deux abords signent un souci constant pour leur matière, leur densité, leur obscurité, leurs mouvements, leurs surprises. À l’inverse, certains discours d’aujourd’hui font usage d’un langage pauvre, sans splendeur, vidé de tout potentiel à déchiffrer comme de matière à entendre et à faire résonner.
Les deux versants de la dépathologisation
Pénélope Fay
n°50
 Dans la famille de la « dépathologisation » Pas de psychanalyse sans parole ni langage. Au même titre que l’inconscient et l’interprétation, la parole et le langage pourraient être aussi considérés comme des « mots de la tribu » . Mais au même titre que le statut de l’interprétation peut être repensé selon que celle-ci est ponctuation ou coupure, la parole peut être conçue selon son versant autistique, vecteur de satisfaction, d’apparole. Le langage, lui, bien loin d’être seulement le réceptacle et le tourniquet des significations, peut être lieu et occasion de résonances, mettant « en valeur la matière qui, dans le son, excède le sens ». Ces deux abords signent un souci constant pour leur matière, leur densité, leur obscurité, leurs mouvements, leurs surprises. À l’inverse, certains discours d’aujourd’hui font usage d’un langage pauvre, sans splendeur, vidé de tout potentiel à déchiffrer comme de matière à entendre et à faire résonner….
Dans la famille de la « dépathologisation » Pas de psychanalyse sans parole ni langage. Au même titre que l’inconscient et l’interprétation, la parole et le langage pourraient être aussi considérés comme des « mots de la tribu » . Mais au même titre que le statut de l’interprétation peut être repensé selon que celle-ci est ponctuation ou coupure, la parole peut être conçue selon son versant autistique, vecteur de satisfaction, d’apparole. Le langage, lui, bien loin d’être seulement le réceptacle et le tourniquet des significations, peut être lieu et occasion de résonances, mettant « en valeur la matière qui, dans le son, excède le sens ». Ces deux abords signent un souci constant pour leur matière, leur densité, leur obscurité, leurs mouvements, leurs surprises. À l’inverse, certains discours d’aujourd’hui font usage d’un langage pauvre, sans splendeur, vidé de tout potentiel à déchiffrer comme de matière à entendre et à faire résonner….
Nostalgie dialectique
Pénélope Fay
n°49
 Vème siècle avant J.-C. : Socrate vise, par ses questions, ce qui est insu de ses interlocuteurs. Il draine avec lui ses acolytes sur l’agora, tous fascinés par l’aiguillon de son désir, qui s’appelle vérité. Socrate cherche à la débusquer. Que la lumière soit faite sur ce qui demeure tapi.
Vème siècle avant J.-C. : Socrate vise, par ses questions, ce qui est insu de ses interlocuteurs. Il draine avec lui ses acolytes sur l’agora, tous fascinés par l’aiguillon de son désir, qui s’appelle vérité. Socrate cherche à la débusquer. Que la lumière soit faite sur ce qui demeure tapi.
Pour ce faire, presque tous les moyens sont bons, surtout le langage, lorsqu’il se fait question. Socrate est-il un rhéteur ? Si la rhétorique est l’art de bien parler, Socrate n’en veut pas ; moins lui importe la forme que le fond. C’est d’ailleurs l’objet de ses joutes avec les sophistes en général et Gorgias en particulier, dans le dialogue du même nom.
Puisque les sophistes enrobent leurs propos et misent sur le bel habillage, Socrate n’y voit que l’art du mensonge. Ses efforts pour présenter chacune des étapes de l’argumentation est un déshabillage des étapes de la pensée.
C’est pourquoi, lorsque l’on lit les dialogues platoniciens, il n’est pas envisageable d’en perdre une miette ; sauter une ligne est un crime de lèse-majesté. C’est là le sérieux de la dialectique : la démonstration se veut dans son entièreté. Les propositions particulières sont comprises dans les universelles, tel un jeu de poupées gigognes où l’on ne peut s’autoriser à flâner, à papillonner, à attraper ce qui nous arrange. Il faut déplier tout cela, revenir aux sources, repérer les propositions, crayon à la main, lire, relire et parfois même faire un schéma pour ne pas s’en retrouver déboussolé.
Aujourd’hui, il est de nombreux domaines où l’art de parler supplante l’argumentation. À l’ère de la post-vérité, on se moque bien du terreau, des origines et de l’historicité. Qu’importe, au final, entend-on attristés : tous se valent… Hacher en petits morceaux les raisonnements, garder les parties qui plaisent parce qu’elles claquent, et ne rien vouloir savoir du parfum brun qui les embaume. À l’opposé du déshabillage de l’argumentation et de l’entrelacement des arguments, les idées déboulent comme des blocs. Et la certitude comme réponse est aussi l’outil permettant de ne surtout pas toucher ni déplier une argumentation déjà fragile, discutable, aux antipodes
de l’éthique.
Ce numéro d’Ironik ! explore les confins des territoires de la science, de la croyance, de la vérité et de la certitude. Bonne lecture !
T’y crois ?!
Pénélope Fay
n°48
 Ça commence dans la cour d’école et ça continue dans les cafés et les couloirs… Un incroyable événement vient provoquer l’étonnement de celui qui en fut le témoin puis le rapporteur à celui qui voudra bien l’écouter. « T’y crois ?! » L’adresse première, interrogative, peut parfois s’accompagner de la forme inversée : « J’y crois pas… »
Ça commence dans la cour d’école et ça continue dans les cafés et les couloirs… Un incroyable événement vient provoquer l’étonnement de celui qui en fut le témoin puis le rapporteur à celui qui voudra bien l’écouter. « T’y crois ?! » L’adresse première, interrogative, peut parfois s’accompagner de la forme inversée : « J’y crois pas… »
En même temps que l’expression est devenue familière, l’étonnement s’est amoindri, la question est devenue factice, l’appel à sa propre croyance ou à celle du comparse, vite recouverte.
Aujourd’hui, la croyance – celle qui divise, celle qui creuse – a mauvaise presse. La vérité est désuète, les promesses moquées. L’incroyance a pris le pas. C’est l’Unglauben1 épinglée par Freud à propos de la paranoïa.
Si cette dernière nous semble pourtant bien toute animée de croyance2, c’est pourtant l’incroyance fondamentale qui la caractérise. Rappelons les propos de Lacan à ce sujet : l’ouverture dialectique y est interdite puisqu’il y a solidité, prise en masse de la chaîne signifiante primitive3. L’un des termes de la croyance, le sujet divisé, n’y est plus, puisque « Pour un sujet divisé – celui pour qui une partie de l’appareil psychique est inconscient –, la croyance n’est jamais pleine ni absolue »4.
La division laisse des trous, des espaces, des vacillements. La certitude amarre. Et la solidité, voire la fixité, avorte souvent toute dialectique : pas de mouvement, pas de tâtonnements, pas de progressions.
La dialectique, c’est une marche de la pensée. Lorsque l’on étudie la philosophie, on apprend cela : partir d’une thèse, puis la réfuter, pour ensuite faire la « synthèse » des propositions contradictoires. Thèse, antithèse, synthèse. Mais ce mouvement ne se fait pas une fois pour toutes : avoir fait l’unité des propositions contradictoires ne clôt aucun sujet. Ensuite, on recommence, à partir d’une autre idée ou parce qu’autour de soi, ça bouge.
Si aujourd’hui le sol est mouvant, « l’incroyance [qui] a tendance à glisser vers la certitude »5, fleurit, tout comme les théories du complot dont on peut apprécier la variété sur internet, ce puit où l’information et la désinformation pullulent. Le journaliste Serge July nous le rappelait : « Multiple, l’information numérique n’a plus de centre au sens formel du terme. Ce modèle a remplacé le modèle vertical dans lequel une autorité […] produisait la croyance »6.
L’autorité est moquée, celle de la science comme celle de la politique. Ce 48ème numéro d’Ironik ! explore le discours de la science comme la déconstruction des semblants. La dialectique qui sillonne entre les textes vise l’orientation vers le registre du réel. Une lecture oxygénante !
1 Freud S., « Manuscrit K », Naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1996, p. 129-137.
2 Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 215-216.
3 Ibid.
4 Arpin D., « Une époque foncièrement incroyante », La Cause freudienne, n° 90, 2015, p. 93.
5 Ibid.
6 July S., « Je ne suis pas toujours de mon avis », La Cause freudienne, n° 90, op. cit., p 105.